Quand la question de définir mon approche du concept d’utopie s’est posée, je me suis d’abord demander par où commencer. Dois-je partir d’une définition, d’une interprétation officielle et reconnue de ce qu’est une utopie, comme on nous l’a appris pour toute démonstration ? Rien de plus simple aujourd’hui, une recherche rapide sur internet à « utopie définition », et nos amis M. Robert et la rousse nous éclairent d’une réponse universelle. Mais quel intérêt alors ? Demandez-leur vous-même.
Je choisis plutôt, un peu égoïstement, de vous parler de moi et de ce qui me ramène à ce concept d’utopie. Ce qui me vient en premier lieu quand je me penche sur cette notion, c’est une certaine idée du bonheur, de la recherche de celui-ci. Une quête qui prend racine et fleuri dans nos imaginaires.
Si nos imaginaires ont toujours été stimulés par des rencontres, des récits, des découvertes, nos propres récits intérieurs ont toujours dû prendre le temps d’assimiler et interpréter ces stimuli.
Du moment où j’ai su lire, j’ai lu. Des romans surtout, qui prenaient place dans des mondes imaginaires, ressemblant au notre tout en étant différents. Je les dévorais, en boulimique de lecture, ils nourrissaient mon esprit et ma recherche du bonheur d’autant de voies possibles. Le voyage en lui-même n’est-il pas aussi la recherche d’un autre bonheur ?
Puis le monolithe est arrivé, ce dieu-téléphone et son jumeau internet qui sait tout et voit tout. Et je n’ai plus lu. Aujourd’hui les écrans, les réseaux sociaux, les IA même, comblent nos besoins de réponses, tels des buffets à volonté de dopamine, dans une instantanéité et un flux constant qui ne laisse plus place à ces moments suspendus. C’est tellement plus simple de regarder, plus rapide aussi. Fast food du bonheur, aussi bonne pour les artères de nos imaginaires que l’est un maxi best of pour nos artères de chair.
C’est qu’il est bien fait ce petit parasite, extension parfaite de nos corps imparfaits. Attention, il y a du bon dans ces raccourcis infinis, ces fenêtres grandes ouvertes sur le reste du monde. Le problème c’est l’excès, pas l’accès.
Pourtant, malgré toutes ces promesses tenues d’instantanéité du plaisir et de réponses à tout, quelque chose me manque dans cette recherche d’un bonheur différent. Prendre le temps.
Ne pas savoir. Imaginer.
Chercher c’est ne pas avoir encore trouvé, après tout.
J’ai repris la lecture.

Le Rêve

Le Manifeste

L'Intime
À mes yeux, l’utopie est une allégorie de la Caverne de Platon, des plans de Truman Show avec un Jim Carrey évoluant dans un monde qui se révèle finalement comme une illusion ; Dans une histoire où il n’est pas l’acteur mais plutôt le spectateur de sa vie, puisque tout a été décidé pour lui depuis sa naissance , sans qu’il ne le sache. Puisque chaque élément, chaque personne, chaque parole, ont été inscrits dans un script, un scénario visant à divertir la société. Jusqu’au moment où il finit par se rendre compte de la mascarade de cette immense pièce de théâtre, et qu’il a été manipulé comme une marionnette en bois.
Une utopie serait donc un monde dans lequel on a grandi, dans lequel on a absorbé des informations comme une tabula rasa sans en questionner sa véracité, sa justesse. On nous a biberonné à une réalité qui nous est propre, que l’on nous a donnée, de par l’environnement dans lequel nous avons vécu, l’éducation que nous avons reçue. Elle a également été conçue de par notre histoire et de par les personnes que nous avons rencontrées, et dont chacune nous apporte une certaine expérience de vie.. Par transmission et retransmission, on a nourri notre bibliothèque cérébrale, par des représentations visuelles, par des notions, par des valeurs, par des codes, par des croyances, par des limites. Notre matrice a été formatée. Notre carte-mère codifiée.
Nous arrivons donc à un point, persuadés, que la perception que l’on nous a légué par héritage familial, environnemental ou sociétal, est la seule et l’unique vérité, l’unique perception de ce qui est vrai, authentique, puisque finalement, nous n’avons jamais voyagé aux confins de son territoire. Puisque finalement cette vision, nous nous la sommes appropriée, sans s’imaginer une seule seconde que quelqu’un d’autre, de par son vécu, aurait tout simplement une autre vision des choses, une autre perception, une autre trame liée à son histoire, un autre script, un autre scénario.
Puisque nous sommes si attaché.e à cette vision, à quoi bon la questionner ? Pourquoi faudrait-il se confronter à sa toute puissance ? Si nous finissons par admettre que celle-ci n’est pas la vérité absolue, et que la réalité est finalement une alliance, une multitude de perceptions, ne serions nous pas brisé.e par ces révélations ? Ne serions nous pas déstabilisé.e par un sentiment d’illégitimité de nos croyances ? De nos propres visions par rapport aux éléments qui nous entourent ? Finalement, il peut être rassurant et en même temps si délétère de rester dans un environnement que l’on a apprivoisé, que l’on a fini par maîtriser, jusqu’à avoir cette fausse idée que l’on a le contrôle dessus. Jusqu’à avoir cette croyance que l’on est pleinement architecte des images que l’on nous impose au cœur de notre palais mental. Jusqu’à se convaincre que notre identité personnelle s’est forgée par une construction qui nous est propre.

Le Manifeste

Le Rêve

L'Intime
La lecture a souvent été pour moi synonyme de cauchemar à cause de ma dyslexie. J’avais du mal à lire longtemps sans m’endormir de fatigue. C’était une véritable contrainte. Mais les livres ont tout de même été très présents dans la construction de mon imaginaire, grâce à ma sœur, par le prisme de l’oralité. Elle me racontait, le soir pendant les vacances scolaires, les livres qu’elle lisait durant la journée. Il y était souvent question de mondes imaginaires, magiques, où tout ce que l’on souhaite se réalise. C’est comme ça que j’ai découvert l’utopie.
C’était un roman, récit d’une utopie : un monde “parfait” où tout le monde est physiquement “parfait”. Mais quelque chose clochait, je ne me retrouvais pas dans la vision de la beauté qui y était dépeinte. Au fil de la lecture, comme les personnages, j’ai découvert les anomalies d’un système qui se veut utopique, ses limites, sa violence parfois. J’ai découvert la notion de dystopie.
J’ai compris qu’une utopie est personnelle, qu’elle correspond seulement à la personne qui l’imagine. Et bien qu’il y ai aussi des utopies collectives, qui regroupent un certain nombre de personnes (comme le désir d’un monde plus sain pour tous), elles ne sont jamais universelles, et impliquent des contraintes et des sacrifices, inévitablement.
Aujourd’hui, j’ai compris que les utopies apparaissent pour contrer un aspect de nos vies qui ne nous plaît pas, que ce soit sur le plan politique, social ou environnemental. Elles apaisent nos frustrations, soignent nos regrets, calment nos déceptions, à travers le prisme de l’imaginaire et de l’espoir.
Et c’est cette dimension libératrice et apaisante de l’utopie qui me parle aujourd’hui. Je continue à croire en la force des contes de fées, et j’ai gardé mon regard d’enfant sur ces mondes rêvés.
C’est pour cela que parfois, quand je pars en vacances avec ma sœur, elle me raconte encore les livres qu’elle lit.

Le Rêve

Le Manifeste

L'Intime
Avec Good bye Lenin!, film se déroulant en Allemagne lors de la chute du mur de Berlin et relatant de façon critique mais avec une certaine nostalgie la République Démocratique Allemande, j’ai découvert une représentation plus ancrée encore dans la réalité.
Comme dans ces films qui dépeignent clairement des dystopies, aucun régime dans l’histoire ne s’est jamais proclamé être une dystopie. Ils s’identifient toujours dans leurs mythes et leur propagande à une utopie.
Étant Franco-Hongroise, pour moi l’utopie évoque le régime politique de la République Populaire de Hongrie mis en place en 1949 sous la pression de l’Union Soviétique et qui dura jusqu’en 1989. Dans ma famille hongroise, mes arrières grands-parents, mes grands-parents, et même ma mère sont restés fidèles à l’utopie communiste et ce malgré l’évidente dystopie qu’elle s’est révélée être. Mon arrière grand-père communiste, a disparu un jour de 1949 et est réapparu cinq années de détention et de tortures plus tard, sans procès, et sans plus d’explications. Pourtant il persistera à considérer la dystopie communiste comme une utopie jusqu’à la fin de ses jours.
Bien qu’au départ le communisme hongrois ait été l’un des régimes dictatoriaux les plus répressif du bloc socialiste, à partir des années 60 le système devient plus “libéral” et la répression moins présente. La police secrète, moins violente que sous le régime précédent, demeure active, et les communistes contrôlent totalement la vie politique. La censure des arts, même allégée, reste présente. Les conditions de vie étaient alors généralement considérées comme meilleures que celles d’autres pays du bloc de l’est.
Ma mère est née en 1961, elle a connu uniquement cette seconde époque «libérale» de la République Populaire. Elle a vécu sa jeunesse dans ce régime, et a adhéré à son idéologie. Aujourd’hui elle s’en rappelle avec nostalgie, d’autant plus facilement peut-être, qu’elle n’en a pas souffert.
Étant née peu de temps après le changement de régime, je n’en ai connu que des traces et il m’est difficile de comprendre la nostalgie de ma mère. Il s’agissait dans les faits d’un système qui n’admettait pas la démocratie. Et même si lors de mes cours d’histoire en Hongrie, l’ancien régime était critiqué, on peut se poser la question de savoir si une déconstruction et un questionnement en profondeur de ce système politique ont réellement été faits, tant la société qu’a bâti le gouvernement actuel présente des ressemblances.
C’est en tout cela que l’idée d’utopie m’apparaît contradictoire, belle en théorie, ses tentatives de traduction dans la réalité se sont toujours révélées être des dystopies.
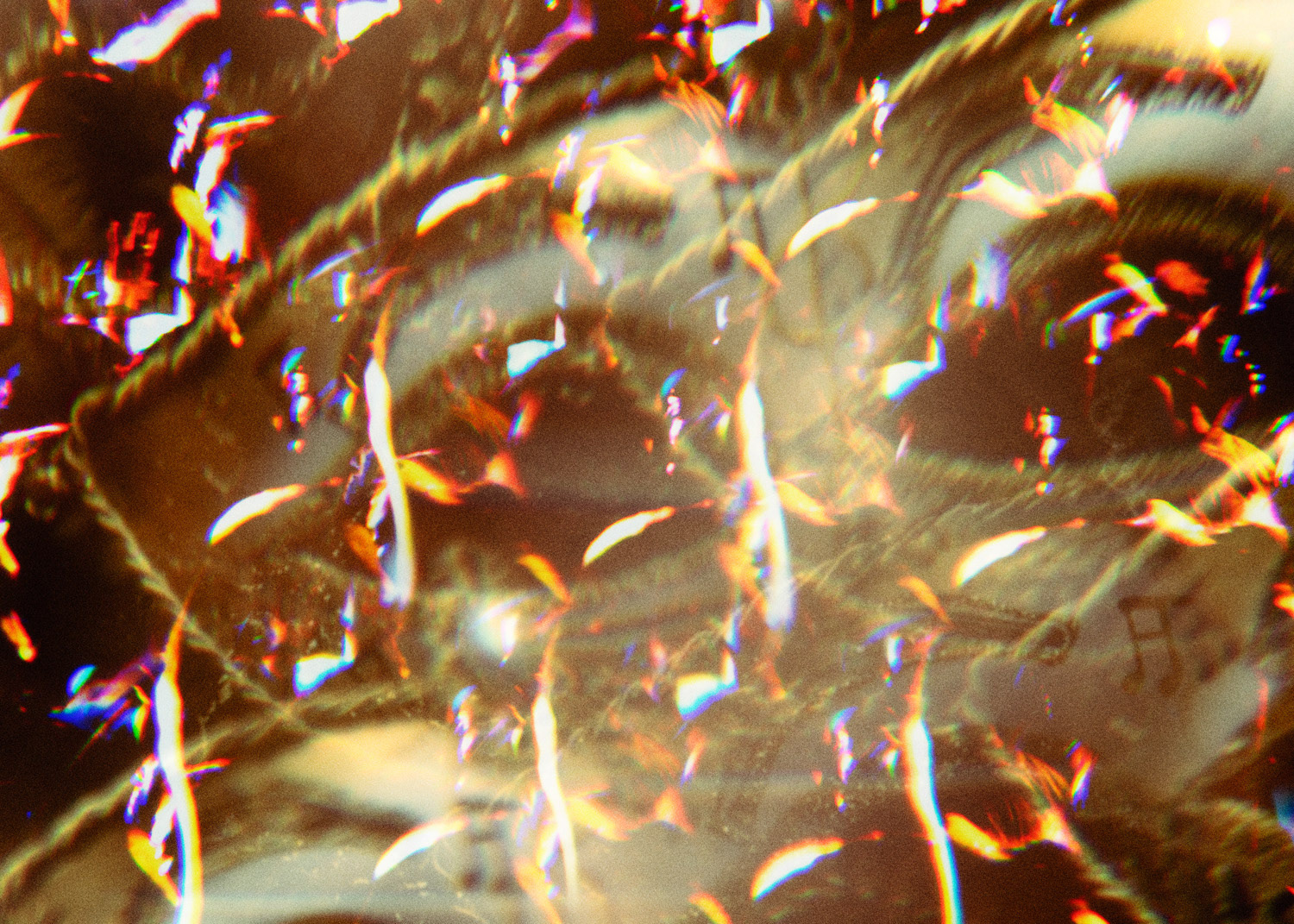
Le Manifeste

L'Intime
